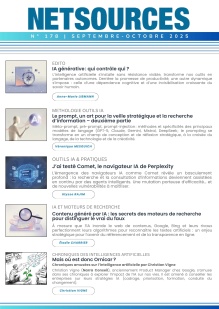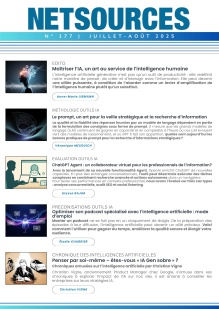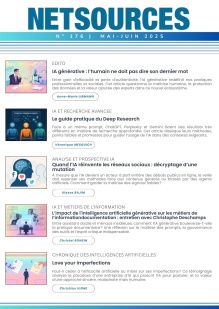-
Vous êtes ici :
- Accueil
- Publications
- Netsources
Sélectionner le numéro de "Netsources" à afficher
Sommaire mars/avril 2018
PANORAMA
• A la recherche de ces « chères » études de marché
METHODOLOGIE
• Comment bien interroger Google en 2018 ?
MOTEURS DE RECHERCHE
• Quick Search : quand la veille vient au secours de la recherche
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
A la recherche de ces « chères » études de marché
Les études de marché offrent une forte valeur ajoutée car elles associent à la fois un travail de compilation de données précieuses et une analyse approfondie.
Mais elles ont la réputation d’être chères, très chères même. Faut-il pour autant faire une croix sur ces sources si l’on ne dispose pas d’un budget suffisant ou d’un accès aux principales sources et bases de données qui en proposent?
Dans cet article, nous avons choisi de proposer un panorama de l’offre en matière d’études de marché, qu’elles soient accessibles en ligne gratuitement ou selon un modèle traditionnel payant, tout en analysant les avantages et limites de ces différentes solutions.
- Comment interroger le Web pour obtenir des études de marché gratuites ou très bon marché ?
- Qui sont ces acteurs qui proposent des abonnements « abordables » pour accéder à des études ? Qu’est-ce que cela inclut vraiment ?
- Quelles sources proposent des études de marché payantes et souvent très onéreuses : cabinets d’études, agrégateurs d’études, bases de données, etc. Et surtout comment peut-on évaluer a priori la qualité et la valeur ajoutée d’une étude, la réputation de son éditeur avant d’y mettre le prix ?
Les études de marché au sens large
Derrière le terme « étude de marché », il existe en réalité une multitude de définitions différentes. : on y trouve des études qualitatives, quantitatives, sectorielles, etc.
Certains acteurs lui appliquent une définition très stricte là où d’autres englobent toute forme de rapports ou d’études courtes ou longues incluant des données de marché.
Nous avons choisi dans cet article une définition large des études de marché tout en nous focalisant sur les études multi-clients disponibles en ligne gratuitement, à l’achat ou via un abonnement. Car, en fonction des problématiques de chacun, on pourra trouver un intérêt dans chaque type d’études et y repérer des données de marché.
Pour les professionnels de l’information, les études de marché représentent une source parmi d’autres pour obtenir des informations qui seront ensuite recoupées et couplées avec d’autres. Mais elles ne vont généralement pas satisfaire l’intégralité des besoins car les problématiques du client sont toujours particulières et spécifiques.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Comment bien interroger Google en 2018 ?
Dans un article publié sur notre blog « Google évolue : les documentalistes plus utiles que jamais », nous faisions le constat que Google affiche toujours moins de résultats et ce, quelle que soit la requête et alors que son index ne cesse pourtant de s’accroître.
Il annonce certes dans un premier temps des centaines de milliers voire des millions de résultats mais en se rendant sur la dernière page de résultats, on constate que leur nombre ne dépasse pratiquement jamais les 500.
Pour preuve, nous avions réalisé en 2011 une recherche sur les masques respiratoires. A l’époque, une requête sur l’expression masque respiratoire permettait de visualiser plus de 1 000 résultats dans Google. Aujourd’hui, la même requête n’en génère que 183.
Aujourd’hui, peut-on encore bien interroger Google ? Est-il possible d’optimiser sa recherche sur le moteur ? Ou bien faut-il admettre que toute recherche sur le moteur sera par principe erratique ?
Peut-on encore confier sa recherche d’information à Google ?
Interroger les moteurs, c’est d’abord s’interroger sur ce que l’on recherche.
Les moteurs de recherche vont généralement s’avérer efficaces quand on recherche une réponse simple à une question simple, une information ou un document précis : une date, un chiffre, un nom, un article, un site, etc.
Attention cependant : ce n’est pas parce que l’information ou le document ne se retrouve pas sur Google qu’elle/il n’existe pas.
Même si l’index des moteurs ne cesse de croître, les moteurs généralistes sont toujours loin d’indexer l’intégralité du Web.
Et c’est sans compter sur toutes les informations de qualité que l’on trouve également en dehors du Web comme dans les revues papier, au travers de contacts humains, etc.
En revanche, cela se complique quand on a besoin d’une sélection d’informations et de documents sur un sujet, un comparatif, une synthèse d’informations, une vision globale d’un marché, d’un secteur ou d’une thématique en vue de faire le tour d’un sujet. Et la baisse du nombre de résultats ne fait qu’aggraver le problème.
Même si, pour ce type de problématique, l’information fournie par les moteurs sera nécessairement parcellaire, on peut tout de même optimiser sa recherche en ciblant au maximum ses besoins et en tirant parti des fonctionnalités avancées des moteurs.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Quick Search : quand la veille vient au secours de la recherche
Talkwalker, acteur présent sur le marché de la veille depuis une petite dizaine d’années est surtout connu pour sa plateforme de social media monitoring du même nom et pour les Talkwalkers Alerts, un système d’alertes Web gratuit fonctionnant sur le même principe que les Google Alertes.
En février dernier, Talkwalker a annoncé le lancement d’un nouveau produit appelé Quick Search, qui se définit comme un moteur de recherche permettant d’interroger avec une antériorité de 13 mois les médias sociaux, sites d’actualités, blogs et forums.
A l’origine de ce projet, il y a un besoin régulièrement évoqué par un certain nombre de clients de la plateforme Talkwalker : celui de pouvoir effectuer librement des recherches d’antériorité sans limite de volume sur n’importe sujet.
Dans la plateforme de veille Talkwalker, les clients peuvent avoir accès au maximum à 2 ans d’archives mais il y a une limite mensuelle, au-delà de laquelle les données sont facturées en plus de l’abonnement. Ces données sont liées aux veilles qui ont été mises en place par le passé, elles ne couvrent donc pas tous les sujets ni tous les secteurs d’activité.
Quick Search est disponible sur abonnement pour 500 euros par mois soit comme un produit à part, soit comme un add-on pour les clients de la plateforme.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Sommaire janvier/février 2018
PANORAMA
• La veille et la recherche d’information à l’heure de la recommandation de contenus
COMPTE RENDU DE SALON /CONFÉRENCE
• L’intelligence économique et ses enjeux pour les entreprises françaises
AGENDA
• L'information au service de la prise de décision est-elle un mythe ?
INDEX ANNÉE 2017
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
La veille et la recherche d’information à l’heure de la recommandation de contenus
La recommandation de contenus prend une place toujours plus importante dans l’univers du Web avec l’accroissement de la recommandation humaine, lié d’une part, au développement des médias sociaux et des outils du Web 2.0 et d’autre part, à la multiplication des systèmes et algorithmes de recommandations automatiques, grâce aux progrès de l’informatique d’abord et plus récemment de l’intelligence artificielle.
Quand on pense aux systèmes de recommandations, on pense en premier lieu aux sites d’e-commerce tels que Amazon qui nous propose des produits similaires à ceux que nous consultons ou susceptibles de nous intéresser, Netflix qui nous recommande des séries et des films qui pourraient nous plaire ou encore Spotify qui nous signale des morceaux et artistes correspondant à nos goûts musicaux.
Mais aujourd’hui, la recommandation est partout et il ne se passe pas un mois sans que l’on ne voie surgir une nouvelle fonctionnalité ou de nouveaux outils grand public et professionnels nous promettant de nous faire découvrir automatiquement des contenus nouveaux qui pourraient nous intéresser et nous faire sortir de notre bulle informationnelle ou des contenus similaires à ce que nous consultons.
En quoi ces systèmes de recommandation modifient-ils nos pratiques de recherche d’information et de veille ? Quelle est leur valeur ajoutée dans un contexte professionnel ?
Les systèmes de recommandation se cantonnent-ils aux outils grands publics ou bien sont-ils également présents dans les outils de recherche et de veille professionnels ?
Et cela nous permet-il véritablement de découvrir des contenus nouveaux que nous n’aurions pas identifiés par d’autres moyens, d’aller plus loin dans le Web profond ou bien, au contraire, cela nous enferme t-il toujours un peu plus dans notre bulle informationnelle tout en nous « noyant » toujours plus sous l’information ?
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
L’intelligence économique et ses enjeux pour les entreprises françaises
Table ronde du 6 décembre 2017 à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco)
Bien que la notion d’intelligence économique puisse trouver sa genèse dans l’Antiquité, c’est aujourd’hui qu’elle prend tout son sens, représentant désormais une panoplie de savoir-faire et un fort enjeu face à la multiplication des acteurs et des environnements à surveiller, mais aussi face aux flux massifs d’information à analyser.
Toutes les entreprises n’ont pas de service d’intelligence économique dédié, mais chacune d’entre elle a grand avantage à la pratiquer pour rester compétitive sur un marché globalisé en constante mutation. C’est dans cette perspective que Julien Vercueil, maître de conférences à l’Inalco, a organisé au sein de l’Institut, le 6 décembre dernier, une table ronde sur l’intelligence économique et ses enjeux pour les entreprises françaises. Celle-ci visait à présenter de manière opérationnelle le métier de l’I.E en entreprise, à un public majoritairement composé d’étudiants en langues et suivant un double cursus de commerce international.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Sommaire novembre/décembre 2017
PANORAMA
• Peut-on encore réaliser une veille avec des outils gratuits en 2017 ?
OUTILS DE VEILLE
• L’IA au service de la reconnaissance d’images
CAS PRATIQUE
• Peut-on se limiter à une veille sur les médias sociaux ? Le cas des projets éoliens.
TENDANCES
• Veille multilingue : les outils de traduction automatique peuvent-ils suffire ?
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Peut-on encore réaliser une veille avec des outils gratuits en 2017 ?
La veille, même si on a trop souvent tendance à l’oublier, est, avant tout, une habile combinaison entre des compétences humaines, des outils et des méthodes.
La question des outils de veille occupe depuis toujours une place prépondérante dans les discussions autour de la veille reléguant souvent en arrière-plan la question de l’humain qui est pourtant indispensable. Et autour de ces questions revient souvent l’éternelle dichotomie entre le gratuit et le payant...
Il y a souvent une confusion entre le fait de réaliser une veille sans budget, « gratuite », et le fait de réaliser une veille à partir d’outils gratuits, qui sont deux concepts très différents.
Une veille gratuite ou sans budget n’existe pas car il n’existe pas d’outil gratuit permettant d’automatiser l’intégralité du cycle de veille, qui rappelons-le, passe par l’analyse des besoins, la mise en place de la stratégie de recherche, le sourcing (c’est-à-dire l’identification des sources pertinentes), la mise sous surveillance des sources identifiées et la collecte des informations, la capitalisation de l’information et l’analyse et la diffusion au public concerné. Il y a et il y aura toujours une part d’humain dans le processus, qu’il soit réalisé en interne ou bien externalisé à des prestataires extérieurs. Et ce temps humain a un coût.
Les outils, aussi bien gratuits que payants, jouent évidemment un rôle important dans le processus mais certaines phases de la veille sont plus sensibles à l’automatisation que d’autres. Et c’est la phase de collecte qui est la plus propice à l’utilisation d’outils permettant d’automatiser des tâches très répétitives où l’humain n’apporte aucune valeur ajoutée comme celles d’aller surveiller l’apparition d’un changement ou d’un mot-clé sur une page Web.
Rappelons-le, ce qu’on appelle communément les outils de veille gratuits sont en réalité des outils de collecte et ne peuvent être utilisés précisément que pour cette phase. Ils n’ont que très peu d’utilité pour les autres phases du cycle de veille, mentionnées ci-dessus, et qui sont essentiellement des opérations intellectuelles.
Les plateformes de veille payantes, vont, quant à elles, intervenir à différents niveaux du processus de veille et pas uniquement lors de la phase de collecte mais cela ne signifie pas pour autant que la veille avec ces outils est entièrement automatisée. Les opérations intellectuelles y ont toujours leur place. Au niveau du sourcing, ces plateformes proposent souvent des corpus de sources pré-packagés qui résultent d’un travail humain, du moins en partie, la mise en place des stratégies et des requêtes repose sur une réflexion humaine, les dashboards d’analyse et de visualisation fournis par ces outils n’ont de sens que s’il y a une analyse humaine des données et la diffusion, bien qu’en partie automatisée, requiert un minimum de filtrage humain et de mise en forme pour répondre aux besoins précis des utilisateurs.
Nous rencontrons très souvent des professionnels dont la veille est une de leurs attributions mais qui n’ont d’autre budget que leur temps de travail humain et n’ont donc pas les moyens d’acquérir le moindre outil payant.
Comment réaliser une veille dans ces conditions en 2017 ? Comment réussir et quelles solutions sont aujourd’hui disponibles pour automatiser la phase de collecte à partir d’outils gratuits ou très bon marché et pour dégager du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée ?
Car si les outils gratuits de collecte existent depuis des dizaines d’années, ils ont considérablement évolué ces dernières années et le paysage a beaucoup changé. Nous avons choisi dans un premier temps de nous intéresser aux grandes tendances impactant actuellement la veille et ses outils car il est primordial de prendre en compte ces différents paramètres lors de la mise en place d’une veille et du choix des outils. Et c’est dans un second temps que nous dresserons un panorama des outils de veille gratuits aujourd’hui disponibles et ce qu’ils peuvent apporter aux veilleurs.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
L’IA au service de la reconnaissance d’images
La reconnaissance d’images, c’est-à-dire le processus d’identification et de détection d’un objet, d’un visage ou d’une caractéristique dans une image n’est pas un concept nouveau mais l’on voit se développer de plus en plus d’applications et de solutions tirant parti de cette technologie depuis l’année 2016, ce qui s’explique par l’accélération récente du développement de l’intelligence artificielle.
Si au départ la reconnaissance d’images était surtout utilisée pour des applications grand public (on pensera notamment à la bibliothèque de photos de l’iphone qui permet d’effectuer une recherche sur un objet comme par exemple « christmas tree » et qui retrouve toutes vos photos représentant un sapin, même en arrière-plan), les acteurs de la veille et surtout les outils de social media monitoring n’ont pas tardé à en tirer parti et à les inclure dans leurs plateformes.
C’est sur ces solutions que nous avons choisi de nous pencher aujourd’hui.
La reconnaissance d’images pour la veille s’applique principalement aux logos
Même si cela peut à première vue surprendre et même paraître très limitatif, la reconnaissance d’images appliquée au secteur de la veille concerne principalement la reconnaissance des logos de marques dans les images sans que la marque ne soit citée textuellement. Il est par exemple possible de repérer les images incluant des bières de marque Heineken même en arrière-plan publiées sur les réseaux sociaux.
La reconnaissance de logos représente indéniablement un fort enjeu commercial pour les marques et notamment les grandes multinationales.
Ce sont ainsi de très nombreuses images qui n’auraient pas pu être repérées par une recherche textuelle. Et même si le taux de précision de ces solutions n’est pas absolument parfait, il avoisine tout de même généralement les 90 %. Certes, il est impossible de vérifier ces chiffres mais les quelques démonstrations que nous avons pu avoir et les quelques tests que nous avons pu effectuer confirment un taux de pertinence élevé.
Pour les entreprises, l’intérêt est multiple. Cela permet :
- de visualiser l’exposition de leur marque sur les réseaux sociaux et de repérer bien plus de mentions que via une recherche textuelle classique ;
- de comprendre les contextes dans lesquels leur marque est la plus utilisée et ainsi mieux cibler leurs actions de communication et de promotion ;
- de découvrir des marques associées à la leur pour d’éventuels partenariats et actions communes ;
- de repérer des influenceurs et promoteurs de la marque ;
- de repérer des détournements de leurs marques (parodies par exemple) ;
- de détecter des éléments négatifs et anticiper de potentiels « bad buzz » (utilisation de la marque par des publics non sollicités par exemple) ;
- de détecter des contrefaçons.
A ce stade, on est encore beaucoup dans la veille d’image/e-réputation et dans la surveillance des mauvais usages des marques et détection des contrefaçons mais il tient fort à parier que l’évolution de ces technologies devrait conduire à d’autres usages prochainement.
Depuis quelques années, plusieurs start-ups se sont positionnées sur le créneau de la reconnaissance de logo parmi lesquelles :
- GazeMetrix qui a été racheté par la plateforme de social media monitoring Sysomos en 2015
- Ditto Labs
- Logograb
- Clarifai
- GumGum
On pourra également citer IBM Image Detection mais qui n’a rien d’une start-up.
Les acteurs de la veille et du social media monitoring ont choisi différentes approches : certains ont ainsi fait le choix d’intégrer dans leurs outils la technologie des acteurs cités précédemment, d’autres ont développé leur propre solution en interne et d’autres encore ont fait le choix d’utiliser les solutions des start-ups spécialisées tout en ajoutant des développements internes.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Les Tags de Netsources
- IA
- brevets
- cartographie
- SEO
- open access
- livrables de veille
- humain
- médias sociaux
- sourcing veille
- flux RSS
- professionnel de l'information
- open data
- recherche vocale
- information business
- agrégateurs de presse
- à lire
- conférences salons
- information scientifique et technique
- outils de recherche
- outils de veille
- tendances
- multimédia
- actualités
- méthodologie
- serveur de bases de données
- curation
- due diligence
- recherche visuelle
- outils de traduction
- fake news
- fact checking
- publicité
- géolocalisation
- marques
- appels d'offres
- sommaire
- formation Veille Infodoc
- retour d'expérience
- OSINT
- propriété intellectuelle
- presse en ligne
- recherche Web
- évaluation outils
- références bibliographiques
- résumé automatique
- Bing
- veille collaborative
- veille audiovisuelle
- veille innovation
- infobésité
- études de marché
- données statistiques
- dataviz
- information financière
- LexisNexis
- Newsdesk
- sourcing pays
- veille medias
- veille commerciale
- réseaux sociaux
- newsletter
- veille à l'International
- ist
- ChatGPT
- veille métier
- intelligence économique
- veille concurrentielle
- podcast
- science ouverte
- open source
- veille technologique
- knowledge management
- édito
- Intelligence artificielle
- navigateur IA
- sécurité informatique
- navigateur agentique
- méthodologie et livrables