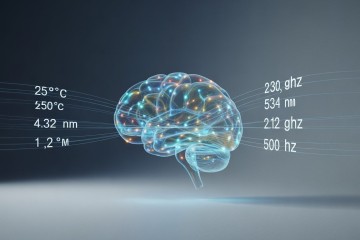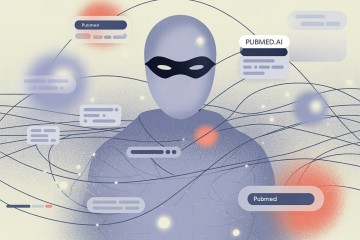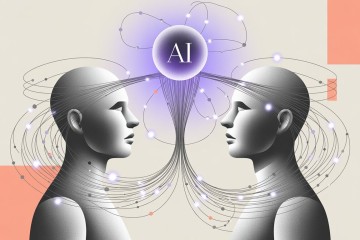Depuis plusieurs siècles les publications scientifiques sont un des fondements de l’évolution de la science. En effet, le plus ancien périodique scientifique le Journal des sçavans est paru à Paris le 5 janvier 1665.
Aujourd’hui plusieurs signes inquiétants viennent mettre en doute la possibilité pour ce système de poursuivre son évolution de façon harmonieuse et de continuer à accompagner l’avancement de la science comme il l’a fait jusqu’à présent.
Une illustration en est la journée 2025 Science ouverte du CNRS sur le thème « La mort annoncée des publications scientifiques ? .
Une croissance incontrôlée
Le nombre de publications scientifiques croît nettement plus rapidement que le nombre de chercheurs. Par exemple, entre 2016 et 2020 les principales bases de données bibliographiques ont grossi de 50 % alors que le nombre de scientifiques n’augmentait que de 16 %. C’est ce qu’on lit dans le BlogCNRS du 16 décembre 2025 intitulé « Publications scientifiques : une surproduction fatale ? ».
Cette croissance n’est pas uniformément répartie, car certains éditeurs ont, en particulier grâce à la multiplication des numéros spéciaux, des croissances bien supérieures. Elle est de 1 080 % pour MDPI, de 675 % pour Frontiers et de 139 % pour Hindawi. À eux trois, ils ont contribué à plus de 54 % de l’augmentation totale des articles publiés durant cette période.
Le cas d’Indawi est caricatural.
En effet, créé en 1997, il est passé dans les années 2000 progressivement au modèle gold open access (où l’auteur paye des APC - article processing charges) publiant jusqu’à 400 revues. Il est racheté en 2021 par Wiley pour 298 M$. Une crise éclate finalement en 2023 : 8 000 articles, principalement issus de numéros spéciaux, sont rétractés, un record pour un éditeur en une seule année, et Wiley finit par abandonner la marque Indawi en intégrant un nombre limité de ses publications.
Les moteurs de l’inflation éditoriale
Ce développement accéléré du nombre de publications et d’articles est d’abord dû au développement « naturel » de la science qui a pour conséquence une augmentation du nombre des publications selon le schéma traditionnel : création de revues dans des spécialités nouvelles, nouveaux sujets d’étude, etc.
On observe aussi un accroissement de la présence de publications en provenance du monde non occidental qu’on appelle aussi « Sud Global ».