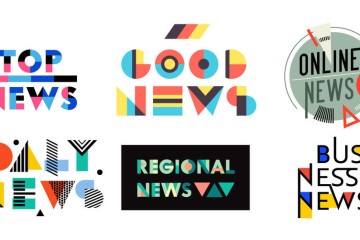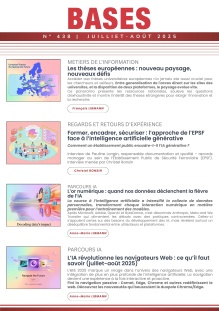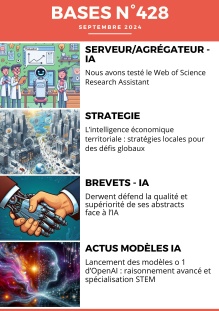-
Vous êtes ici :
- Accueil
- Publications
- Bases
Sélectionner le numéro de "Bases" à afficher
Déterminer la valeur d’un brevet : des outils stratégiques pour l’entreprise
Selon un « mantra » communément trouvé dans la littérature spécialisée, « 80 % de l’information technique trouvée dans les brevets n’est pas présente ailleurs ».
L’information brevet renseigne en premier lieu sur l’évolution des technologies, et sur l’état de l’art, où l’état de la technique dirait un examinateur. Une proportion très importante des documents cités dans les rapports de recherche produits par l’OEB (Office Européen des Brevets) correspond à de la littérature brevet, ce qui souligne l’importance de l’information brevet dans une étude de brevetabilité.
L’INPI (L’Institut National de la Propriété Intellectuelle), au début des années 1980, avait lancé une publication dénommée « Le clignotant des technologies », dont la production était confiée à un service particulier, le RISC, pour « Recherche en Information Stratégique et Concurrentielle ».
Stratégie et concurrence : nous y voilà. En fournissant une visibilité sur l’orientation des axes de R&D des concurrents, l’information brevet constitue une aide à la définition d’une stratégie d’entreprise.
Lire aussi :
Minesoft change d’échelle (Bases N° 400 - fev 2022)
OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) met en ligne des "Patent Landscapes"
Nous avons testé IPRally, l'outil qui veut révolutionner la recherche brevets avec de l'IA (Bases N° 395 - sept 2021)
Cet article est consacré à un aspect très spécifique de l’exploitation de l’information brevet, celui qui, au-delà d’une simple évaluation technique, va jusqu’à une analyse permettant d’estimer la valeur d’un titre ou d’un groupe de titres en tant qu’arme économique au service du jeu concurrentiel.
Nous évoquerons quatre outils disponibles sur le marché permettant une telle évaluation.
Enfin, nous verrons comment France Brevets a fait de la détermination de la valeur d’un brevet une étape clé dans sa démarche d’accompagnement à la mise en place d’une stratégie d’entreprise fondée, en particulier, sur les actifs de propriété intellectuelle. Les échanges que nous avons eus avec les experts qui y officient nous ont beaucoup inspiré dans l’appréhension du sujet. Nous donnerons quelques exemples de la mise en œuvre de ces outils dans une telle démarche.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Canada Explore : un portail pour accéder aux résultats de la recherche canadienne
Canada Explore est un portail permettant d’accéder aux résultats de la recherche canadienne (cf. figure 1. Interface de Canada Explore).
Il a été développé grâce à une collaboration entre la Canadian Association of Research Libraries (CARL) et OpenAIRE, ce qui permet aux résultats disponibles sur le portail canadien d’être aussi disponibles sur OpenAIRE.
OpenAIRE, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, est un portail créé à l’initiative de la Commission Européenne pour retrouver les références des résultats des recherches financées par la Commission, avec un principe de libre accès.
Lire aussi
La veille au défi de l’information scientifique et technique (Netsources N° 149 - nov/dec 2020)
Comment bien rechercher l’information scientifique et technique ? (Netsources N° 149 - nov/dec 2020)
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Comment s’adapter aux nouveautés et restrictions de la recherche d’image inversée sur le Web ?
Savoir réaliser des recherches d’image inversée sur le Web est une des compétences des professionnels de l’information. Si cette technique est toujours d’une utilité certaine, elle a quelque peu été malmenée au cours des dernières années. Et aujourd’hui, elle oscille entre une baisse significative de qualité et l’ajout récent de quelques nouveautés et innovations qui ouvrent de nouveaux horizons pour le veilleur.
On rappellera que la recherche d’image inversée est une fonctionnalité, proposée par la plupart des moteurs d’images comme Google Images ou Bing Images, mais aussi par des outils spécialisés comme Tineye par exemple. Elle permet, à partir d’une image (un fichier image ou l’url d’une image), de retrouver des pages et sites qui utilisent cette même image ou des images similaires.
Cette technique permet ainsi de retrouver des contenus que l’on n’aurait pas pu retrouver en effectuant une recherche textuelle par mot-clé classique.
Lire aussi :
Sourcing pour la veille : pensez à utiliser les images! (Novembre 2017)
Outils de recherche d’images : vers la reconnaissance de texte, objet et visage (Netsources N° 143 - nov/dec 2019)
Les cas où cette technique et ces outils s’avèrent utiles sont nombreux et nous pourrons ici en citer quelques-uns :
- Retrouver des contenus dans des langues que l’on ne maîtrise pas à partir d’une image ;
- Retrouver des produits visuellement similaires, ce qui peut être utile dans le cas d’une recherche de contrefaçons ;
- Savoir comment ses propres images sont réutilisées sur le Web, etc.
Dans cet article, nous explorons les dernières grandes tendances de la recherche d’image inversée pour voir comment cela vient impacter le veilleur dans ses recherches. Nous analysons également les différents outils et méthodes existants aujourd’hui et analysons ce qui fonctionne le mieux.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Clarivate finalise l’achat de Proquest
Nous avions évoqué le rachat de Proquest par Clarivate dans le numéro 392 de BASES (mai 2021) en présentant les deux sociétés et les conséquences possibles de cette acquisition.
Clarivate a annoncé le bouclage de l’opération, qui a été légèrement retardée.
Nous attendons maintenant l’annonce des changements qui ne manqueront pas de se produire.
Lire aussi :
L’acquisition de Proquest par Clarivate ne paraît pas si simple
Le rachat de Proquest par Clarivate : quelles conséquences pour le monde de l’information ?
Sourcing : comment détecter des médias réellement nouveaux ?
La recherche d’information et la veille reposent avant tout sur un bon sourcing : le sourcing clé en main que l’on trouve dans les corpus que les professionnels utilisent au quotidien (agrégateurs de presse, plateformes de veille, etc.) et le sourcing « fait maison » que chacun se doit de mettre en place et faire évoluer régulièrement.
La taille (des milliers voire des millions de sources) et la diversité des sources qui composent aujourd’hui les corpus des outils grand public et professionnels et le confort et la facilité que cela peut procurer ont tendance à faire oublier qu’il y a des angles morts dans chacun de ces outils. Aucun outil ne contient par défaut toutes les sources utiles à la bonne réalisation d’une recherche ou d’une veille. Et c’est au professionnel de constituer un corpus de qualité adapté à ses problématiques précises et surtout de rester en alerte constante pour l’adapter.
Lire aussi :
Avec le Live Streaming, les médias innovent mais le veilleur souffre (octobre 2021)
Peut-on encore utiliser les kiosques numériques pour la recherche presse ? (octobre 2021)
La veille «médias» en 2021 : à la conquête d'un champ complexe et diversifié (Netsources N° 150 - jan/fev 2021)
Recherche et veille sur les articles de presse : entre tradition et renouveau (Netsources N° 150 - jan/fev 2021)
Les nouveaux formats des médias appellent de nouvelles méthodes et outils de recherche et veille (Netsources N° 150 - jan/fev 2021)
Il y a une catégorie de sources qui échappent aux radars des différents outils et qu’il faut impérativement aller identifier par soi-même : les nouveaux titres de presse qui arrivent sur le marché. Et ils sont plus nombreux qu’on pourrait le croire.
Ces nouveaux titres de presse se positionnent souvent sur des créneaux spécifiques (hyper local, thématique ou spécialisé, etc.) et ont toute leur place dans le sourcing du veilleur.
Mais comme ils sont nouveaux, ils sont encore peu visibles et ne sont donc que très rarement intégrés dans l’immédiat aux outils de recherche et de veille.
Comment identifier ces nouveaux médias et titres de presse ? C’est ce que nous verrons dans ce nouvel article de BASES.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
DATA INPI s’améliore pour la veille
Nous avions présenté le portail DATA INPI dans le numéro 378 (février 2020) de BASES.
Jusqu’à maintenant, l’outil se positionnait uniquement sur l’aspect recherche d’information. Depuis peu, il permet également de faire de la veille.
On peut désormais mettre en place, toujours gratuitement, un maximum de 10 alertes simultanément sur une entreprise, une marque, un brevet, un dessin/modèle.
Les résultats des alertes sont envoyés chaque vendredi par courriel.
Lire aussi :
L’information financière et légale sur les entreprises françaises : entre ouverture et fermeture de données (Netsources N° 151 - mars/avril 2021)
L’INPI vient de lancer la base gratuite data.inpi.fr (Bases N° 378 - fev 2020)
L’INPI lance un service de cartographie des inventions (Bases N° 349 - juin 2017)
Rappelons qu’il propose des informations gratuites sur :
- les données sur les entreprises issues du Registre National du Commerce ;
- les marques françaises de l’Union Européenne et internationales ;
- les brevets français, européens et internationaux ;
- les dessins et modèles français et internationaux ;
- les jurisprudences relatives aux marques, brevets, dessins et modèles ;
- les indications géographiques déposées et publiées à l’INPI ;
- un fonds de brevets du 19° siècle.
Facebook News : du nouveau pour la recherche d’actualités
Après les États-Unis en 2019 et le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Australie en 2021, les internautes vont enfin pouvoir bénéficier du nouveau service de Facebook appelé Facebook News. Il a déjà été déployé auprès de quelques utilisateurs en France et devrait être disponible à tous d’ici le mois de mai.
Facebook News est un peu l’équivalent de Google Actualités, mais intégré à Facebook. Il s’agit d’un onglet spécifique à l’intérieur de la plateforme, dédiée uniquement aux articles de presse.
Pour les veilleurs, ce nouveau service attise forcément la curiosité, car la recherche et la veille sur l’actualité représentent une part importante de leur activité et parce que les outils et solutions gratuites disponibles sur le marché sont de moins en moins satisfaisants.
Lire aussi :
L’outil de veille scientifique Meta sacrifié sur l’autel de Facebook
Le nouveau Facebook simplifie-t-il enfin la vie du veilleur ?
Comment surveiller Google Actualités ?
Quelles alternatives crédibles à Google Actualités en 2020 ? Dossier spécial Agrégateurs de presse
Facebook News tombe donc à point nommé.
Mais qu’y trouve-t-on en termes de contenus et quelles sont les fonctionnalités offertes pour y trouver de l’information ? Faut-il y voir un remplaçant de Google Actualités, un complément intéressant ou faut-il juste passer son chemin ? Quelle place peut-il prendre dans la panoplie du veilleur ?
C’est ce que nous avons exploré dans ce nouvel article de BASES.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Tous les outils pour rechercher dans les archives du Web
Le Web change à vive allure et les sites Web que l’on voit aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec ceux d’il y a 5, 10 ou 20 ans. Si cette évolution est bien normale, elle pose un important problème en termes de conservation des données : tous les contenus qui se trouvaient sur ces sites qui ont disparu sont aujourd’hui inaccessibles directement sur le Web ou les moteurs. Et il n’existe que peu de moyens pour les retrouver.
Pour le professionnel à la recherche de contenus anciens (même s’il ne s’agit que de remonter quelques années en arrière), cette quête peut vite devenir compliquée, voire même perdue d’avance.
On a d’un côté les médias qui conservent dans la plupart des cas leurs archives Web. Ainsi une recherche d’antériorité sur ces contenus reste relativement simple. Les médias sociaux quant à eux conservent l’ensemble des contenus (sauf ceux supprimés volontairement par l’utilisateur), comme Twitter par exemple qui permet de rechercher jusqu’en 2006, année de son lancement. Là aussi, une recherche d’antériorité ne pose pas de problème majeur.
Mais pour de nombreux autres sites comme les sites d’entreprises, les sites institutionnels, les sites personnels, il ne subsiste rien quand le site fait peau neuve ou disparaît.
Lire aussi :
Comment retrouver de vieux articles de presse ? (Bases N° 350 - juil/août 2017)
Conseil Veille du 12 mai 2021 pour naviguer dans les archives d’un site web
Outils de recherche sur les contenus audios : un segment encore pauvre (Netsources N° 143 - nov/dec 2019)
Les professionnels de l’information et de la veille connaissent bien la Wayback Machine proposée par Internet Archive depuis de nombreuses années et qui permet de retrouver les archives d’une page Web à condition que la page ait bien été indexée par Internet Archive. Cet outil est très utile et permet de répondre à certains besoins ponctuels. Mais on sait également que malgré toutes ses qualités, la Wayback Machine ne fait pas de miracles. Il subsiste encore de très nombreux cas où l’on n’arrive pas à retrouver ce que l’on cherche.
De nouveaux acteurs ont fait leur apparition au cours des dernières années. Sont-ils capables de répondre à des besoins informationnels pour lesquels Internet Archive nous conduit à une impasse ?
Dans cet article, nous dressons un panorama des outils et ressources disponibles aujourd’hui pour explorer les archives du Web et nous analysons leurs capacités et complémentarités avec la Wayback Machine.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Minesoft change d’échelle
Créée en 1996, Minesoft était quasiment une entreprise familiale, ce qui ne l'a pas empêchée de se développer sur le marché de la PI (propriété intellectuelle) et d’atteindre un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros.
Connu pour sa banque de données de recherche de brevets Patbase, utilisée dans de nombreux pays et en particulier en France, Minesoft a développé différents logiciels pour accompagner cette banque de données.
Minesoft vient d’être racheté par MLM 2, une plateforme d’information et de logiciels créée en partenariat avec Warburg Pincus, une importante société de private equity qui gère 73 milliards d’assets répartis dans 235 sociétés très diversifiées.
Minesoft est la première acquisition de MLM 2 dont l’objectif est, par d’autres acquisitions, de devenir un leader dans les logiciels et le service de propriété intellectuelle.
Lire aussi :
Généralisation de la reconnaissance automatique des éléments chimiques dans les textes
Minesoft/Patbase lance Chemical Explorer
Les banques de données brevets gratuites ou freemium
Si cette première acquisition est significative, on notera que le marché est déjà bien encombré même si l’on peut considérer qu’il se développe et continuera à le faire.
Les relations déjà anciennes avec RWS se poursuivront pour continuer à développer Patbase.
Il faut noter que l’équipe de Minesoft reste en place. Le nouveau responsable du marché français se nomme Alexandre Thibault (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).
Comment faire sa veille tarifaire ? les outils spécialisés et investigations manuelles
Dans le monde professionnel, nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre, à la recherche de tarifs.
Pour certains acteurs qui opèrent notamment une activité en BtoC et vendent des produits de grande consommation, c’est même une activité cruciale et un élément clé de leur veille concurrentielle. Il s’agit alors notamment de surveiller en continu les tarifs et surtout les variations de prix opérés par les concurrents. La veille dite « tarifaire » répond alors à une démarche très structurée et fait appel à des outils capables de mener cette veille à grande échelle.
Pour de nombreux autres acteurs, la recherche de tarifs relève plus de l’investigation ponctuelle que d’une véritable démarche de veille itérative : il s’agit par exemple d’analyser son environnement concurrentiel en essayant d’avoir une vision des tarifs pratiqués par ses concurrents, d’analyser un marché sur lequel on souhaite s’implanter, de faire une première évaluation de fournisseurs ou prestataires éventuels, etc.
Mais les tarifs ne sont pas toujours affichés sur le Web et surtout, ils ne sont pas fixes et exacts. Les tarifs de produits BtoB ou de prestations de services que l’on peut trouver sur le Web permettent certes d’avoir une première idée des tarifs pratiqués, mais les tarifs réels dépendent de multiples critères qui ne peuvent être pris en compte sur une simple page web (taille de l’entreprise, type de mission, nombres de personnes impliquées, etc.). La recherche de tarifs s’avère alors plus aléatoire et compliquée pour les produits vendus en BtoB et l’est encore davantage pour les prestations de service.
Lire aussi :
Sourcing, de la théorie à l’épreuve de la pratique (Netsources N° 146 - mai/juin 2020)
La veille sur les appels d’offres de A à Z (Netsources N° 152 - mai/juin 2021)
Comment intégrer les données d’importation et d’exportation à sa veille concurrentielle ? (Netsources N° 151 - mars/avril 2021)
Le paradoxe des outils de veille gratuits ou freemium (Netsources N° 129N° 129 - juil/août 2017)
- Dans cet article nous étudierons dans un premier temps la partie émergée de l’iceberg de la surveillance de tarifs, à savoir la « veille tarifaire » au sens strict du terme. Nous dresserons un panorama des outils et solutions disponibles aujourd’hui sur le marché.
- Dans un second temps, nous nous intéresserons aux cas où ces outils de veille ne sont pas adaptés et où il faut se tourner vers des investigations ponctuelles et manuelles. À partir d’un cas pratique, nous montrerons quelle méthode adopter et vers quelles sources se tourner quand on est confronté à cette problématique.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Les Tags de Bases
- IA
- brevets
- cartographie
- SEO
- open access
- livrables de veille
- humain
- médias sociaux
- moteurs académiques
- revues académiques
- sourcing veille
- flux RSS
- professionnel de l'information
- dirigeant
- open data
- recherche vocale
- information business
- agrégateurs de presse
- à lire
- conférences salons
- information scientifique et technique
- outils de recherche
- outils de veille
- tendances
- multimédia
- actualités
- méthodologie
- serveur de bases de données
- curation
- due diligence
- recherche visuelle
- outils de traduction
- fake news
- fact checking
- publicité
- géolocalisation
- marques
- appels d'offres
- sommaire
- formation Veille Infodoc
- retour d'expérience
- OSINT
- agenda
- propriété intellectuelle
- presse en ligne
- recherche Web
- évaluation outils
- biomédical
- Questel
- Dialog
- références bibliographiques
- thèses
- résumé automatique
- Bing
- open citation
- Scopus
- veille collaborative
- outsourcing
- veille audiovisuelle
- veille innovation
- infobésité
- études de marché
- données statistiques
- dataviz
- information financière
- Corée du Sud
- Pressedd
- LexisNexis
- Newsdesk
- sourcing pays
- chimie
- e-réputation
- recherche publique
- droit d'auteur
- littérature grise
- archives ouvertes
- veille medias
- dark web
- veille commerciale
- trésor du web
- réseaux sociaux
- veille à l'International
- ist
- ChatGPT
- veille métier
- intelligence économique
- veille concurrentielle
- Bluesky
- podcast
- dark social
- shadow social
- science ouverte
- open source
- veille technologique
- knowledge management
- littérature scientifique
- web of science
- derwent
- abstracts
- protocole
- Intelligence artificielle
- OpenAI
- Commerce conversationnel
- GEO
- veille automatisée
- agents conversationnels
- recherche biomédicale
- veille informationnelle