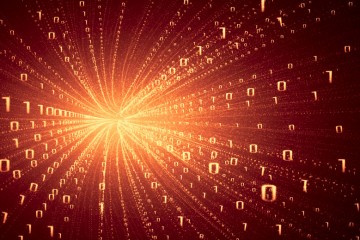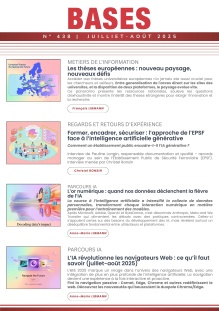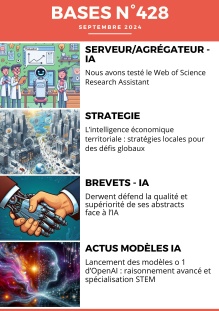-
Vous êtes ici :
- Accueil
- Publications
- Bases
Sélectionner le numéro de "Bases" à afficher
Intelligence artificielle, mobilité, collaboratif, data intelligence, traitement avancé des datas … Comment la transformation digitale transforme l’information et la veille ?
La conférence inaugurale d’i-expo rassemblait Marie-Hélène Ahamada Bacari (Responsable département Veille, Total), Bruno Etienne (Président, KB Crawl), Vincent Boisard, (PDG, Coexel), Antoine Perdaens (CEO, Elium, ex-Knowledge Plaza) et Bernadette Plumelle (Vice-présidente des secteurs de l’ADBS).
Avant d’entrer dans le vif du sujet, les différents intervenants ont été invités à définir leur vision de la transformation digitale.
Pour Antoine Perdaens, la transformation digitale est en route déjà depuis un moment avec la notion de mobilité. Ce qu’il y a de vraiment nouveau, c’est l’intelligence artificielle. Pour Bruno Etienne, on se trouve actuellement à la convergence de plusieurs disciplines et l’on cherche désormais à rassembler l’intelligence artificielle, le big data et la veille.
La conférence s’est ensuite déroulée autour de trois grands thèmes :
- Les enjeux de la transformation digitale
- L’impact sur les métiers de l’information
- Quid de l’avenir ?
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Cikisi, Newscrush et Trafalgraph : de nouveaux visages
Parmi les nouveaux acteurs, nous avons retenu trois noms : Cikisi, Newscrush et Trafalgraph.
Cikisi est une nouvelle plateforme de veille, dans la même veine que des outils comme Digimind, Sindup, Talkwalker, etc. Acronyme de « Catch It, Keep It, Share It », l’outil a récemment été lancé par une start-up belge du même nom.
Elle se veut à la fois plateforme de veille mais également outil de recherche. Le créneau des fondateurs de Cikisi et qui diffère d’un certain nombre de plateformes actuelles est celui d’un sourcing fin et précis réalisé par le client lui-même plutôt qu’un gros corpus de sources déjà paramétré sur lequel le client n’a pas toujours la main.
A la vue de la démonstration à laquelle nous avons assisté, l’outil semble prometteur... Nous aurons l’occasion d’en faire un article détaillé dans Netsources d’ici la fin de l’année.
Newscruch et Trafalgraph sont deux start-ups françaises issues du même incubateur. Même si les deux produits sont différents, le premier utilise la technologie du second pour son système de recommandation de contenu.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
De la recherche d’information vers l’analyse à valeur ajoutée
Marie-Laure ChesneSeck est actuellement consultante pour le cabinet Ourouk, spécialisé en management de l’information. Après une carrière de chercheur en biophysique, elle gère l’information scientifique, puis crée une fonction d’« Intelligence Scientifique » pour le public R&D d’un grand groupe pharmaceutique.
Au travers d’une série de trois articles, je souhaitais partager mon expérience de transformation de la fonction info-doc au sein de la R&D d’un grand groupe pharmaceutique.
La feuille de mission qui m’était confiée était large, et comportait notamment la gestion de la transition avec l’offre de service de l’ancienne fonction info-doc, en accompagnant l’autonomisation des publics, la mise en place d’une offre d’« Intelligence scientifique » en support de la prise de décision, l’assistance à maitrise d’ouvrage, l’animation de systèmes d’information collaboratifs, et la gestion intelligente d’un budget destiné à l’outsourcing d’une partie de l’activité.
Lire aussi :
De l’excellence opérationnelle à une externalisation maîtrisée
Je me focaliserai dans ce premier article sur les pistes que j’ai suivies pour proposer une offre d’analyse à valeur ajoutée, en mobilisant les techniques documentaires déjà maîtrisées, et en empruntant de nouvelles techniques venant de l’intelligence concurrentielle, du marketing stratégique ou de la cartographie de brevets.
La demande principalement formulée relevait de la réalisation de cartographies/état des lieux de l’activité d’innovation sur de grands domaines de connaissance critiques pour la stratégie de l’entreprise. En particulier, mes clients souhaitaient détecter des innovations à des stades de maturité bien particuliers. Ces exigences ont orienté mon choix des sources à utiliser.
Les défis auxquels j’ai été confrontée étaient de plusieurs ordres.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Entre outils gratuits et outils payants, quelles nouvelles méthodes efficaces de veille et de recherche sur le web visible et invisible ?
Cette conférence rassemblait Julie Egal (Market & competitive intelligence, Innovation, chez un grand acteur du tourisme en France), Frédéric Martinet (Consultant veille et intelligence économique, Fondateur, Actulligence Consulting), Thierry Lafon (Chargé d’analyses stratégiques, La Poste), Alfred Huot de Saint Albin (Secrétaire général, AEGE1) et Carole Tisserand-Barthole (rédactrice en chef de BASES et NETSOURCES).
Anne-Marie Libmann, directrice opérationnelle chez FLA Consultants, animait le débat.
“Sur Internet c’est gratuit. Et vous en avez pour votre argent”
Anne-Marie Libmann a souhaité introduire le débat avec une assertion amusante, le slogan d’une publicité Factiva datant d’il y a plusieurs années, indémodable néanmoins : « La triste vérité : sur Internet, l’info est gratuite. Et vous en avez pour votre argent” ».
Quelle résonnance dans le monde d’aujourd’hui ?
Pour tous les participants, il est clair que ce slogan est toujours d’actualité. Même s’il s’appliquait à l’époque à l’information presse et à l’actualité, comme le rappelle Carole Tisserand-Barthole, ce constat est tout aussi valable pour la surveillance du Web et des médias sociaux. Les outils gratuits sont généralement bien plus chronophages que les plateformes payantes et offrent généralement des fonctionnalités plus limitées.
Julie Egal a quant à elle rappelé la loi de Nolan pour la recherche d’information : une information ne peut pas être à la fois de bonne qualité, pas chère, et obtenue rapidement.
Pour Frédéric Martinet, “si c’est gratuit c’est que vous êtes le produit.” La gratuité est une vue de l’esprit. A cette époque de « fake news » et de manipulation de l’information, il est toujours plus important de disposer de médias financés par leurs lecteurs pour la qualité de l’information et non pas par un parti politique ou par des industries pour y véhiculer des messages qui leur seraient utiles.
Thierry Lafon a ensuite proposé une typologie intéressante des outils gratuits qui peuvent être :
- soit des têtes de gondoles ou technologies vitrines d’entreprises qui proposent d’autres services,
- soit des produits gratuits jusqu’à ce que leur renommée permette aux éditeurs de facturer l’utilisation de nouvelles fonctionnalités ou leur utilisation professionnelle,
- soit des outils universitaires qui sont en recherche de financement privé pour poursuivre leur développement ou pour permettre de suivre les évolutions du web
- enfin quelques outils non maintenus qui ont une utilité à un instant T et dont les fonctionnalités se dégradent dans le temps par absence d’évolution.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Sommaire mars 2017
DOSSIER SPÉCIAL : QUI SONT LES NOUVEAUX EXPERTS DES BASES DE DONNÉES EN ENTREPRISE ?
• La formation aux bases de données : l’affaire de tous ?
• Tout commence par l’éducation
• Les étudiants en infodoc sont-ils encore formés aux bases de données ?
• Et si les étudiants hors infodoc étaient même mieux formés aux bases de données ?
• La place des bases de données dans le monde professionnel
• Du côté des éditeurs et producteurs de bases de données
• Sondage auprès des professionnels de l’information
• Est-ce finalement encore une demande des employeurs ?
• Témoignages et retours d’expérience
• Conclusion : quel positionnement pour le professionnel de l’information ?
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Qui sont les nouveaux experts des bases de données en entreprise ? Dossier Spécial
A l’origine de ce numéro spécial, il y a un questionnement autour de l’évolution du métier de professionnel de l’information et de son rapport aux grandes sources d’informations.
Au cours des dernières années, nous avons pu constater au gré de nos contacts avec les éditeurs et producteurs de bases de données que les professionnels de l’information n’étaient plus nécessairement leur principal public ni d’ailleurs leur principale cible. Ceci s’avère particulièrement vrai pour toutes les bases de données business dont financières mais également de plus en plus pour les agrégateurs de presse et d’actualités.
D’autre part, nous avons entendu ici et là le discours récurrent de professionnels de l’information s’étonnant du manque d’expertise des jeunes diplômés en matière de bases de données.
Face à ce constat, il y a pourtant cette image - ou bien s’agit-il d’un mythe ? - toujours bien présente du professionnel de l’information expert de la recherche et des techniques d’interrogation. On rappellera que son champ d’action s’est d’ailleurs considérablement élargi, et il n’est plus question d’interroger uniquement les serveurs et bases de données professionnelles mais aussi plus largement le Web et les médias sociaux avec des méthodologies expertes.
Nous avons choisi de nous focaliser ici sur les serveurs et bases de données qui ont été à l’origine des sources d’informations électroniques et qui restent encore maintenant un élément important dans tout processus de veille et de recherche d’information.
On notera d’ailleurs que ces ressources sont restées l’apanage des professionnels de l’information pendant de longues années tandis que, parallèlement, les opérationnels de l’entreprise et le grand public s’appropriaient la recherche d’information Web et les moteurs de recherche. En considérant d’ailleurs trop souvent que l’information était un bien gratuit et qu’une information non disponible sur Google n’existait pas.
Mais n’y a-t-il pas eu une profonde mutation en la matière au cours des dix dernières années ?
Les professionnels de l’information sont-ils encore formés à l’utilisation de ces sources ? D’autres professions ou diplômés ne sont-ils pas tout aussi bien formés et au fait de ces technologies ? Les nouvelles générations ne sont-elles finalement pas sensibilisées à ces questions dès leur plus jeune âge ?
Face à la simplification des interfaces, est-il encore nécessaire d’apprendre à les utiliser ou bien leur prise en main peut-elle se faire de façon intuitive ? La connaissance et la maîtrise de ces sources est-elle encore seulement une demande des employeurs ?
Et finalement, est-ce que toutes ces évolutions ne nous poussent pas à repenser plus largement le rôle et la valeur ajoutée du professionnel de l’information ?
C’est à toutes ces questions que nous avons essayé de répondre dans ce numéro spécial.
LinkedIn : quand "Pro de l’info" ne rime pas forcément avec base de données - Dossier spécial Qui sont les experts des bases de données en entreprise ?
Pour étayer notre propos, nous avons décidé d’effectuer une première vérification simple en nous rendant sur LinkedIn afin de vérifier si seuls les professionnels de l’information mentionnaient des serveurs et bases de données dans leur profil.
On peut en effet considérer que si une personne y indique des noms d’outils, elle les maîtrise un minimum et leur accorde une certaine importance ou du moins les considère comme une valeur ajoutée à son profil.
Nous avions néanmoins conscience que tout le monde ne dispose pas d’un profil LinkedIn et que des personnes familières avec certaines bases de données professionnelles ne l’indiquent par nécessairement sur leur profil.
Nous avons ainsi effectué plusieurs recherches dans LinkedIn en entrant les noms de différentes grandes bases de données et serveurs et en nous limitant à la France.
Nous n’avons pas été en mesure de réaliser des tests concluants sur tous les noms des principaux serveurs et bases de données car certains noms étaient ambigüs et faisaient également référence à d’autres entreprises ou produits ou bien ne ramenaient presque aucun résultat.
Nous avons également éliminé manuellement les résultats provenant de personnes travaillant ou ayant travaillé pour ces producteurs et éditeurs.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
La formation aux bases de données : l’affaire de tous ? Dossier spécial Qui sont les experts des bases de données en entreprise ?
Tout commence par l’éducation
Les différents éléments que nous avons recueillis lors de notre enquête nous ont conduit à nous interroger sur la formation et la sensibilisation des élèves dès leur plus jeune âge.
N’y a t-il pas une véritable politique de sensibilisation à la question de l’information structurée et à la recherche d’information dès le collège ou lycée ? Ce qui expliquerait alors qu’en arrivant sur le marché du travail, ces jeunes professionnels maîtrisent les rudiments de la recherche d’information et ont conscience de l’existence de ces ressources.
Pour avoir des réponses aux différentes questions que nous pouvions nous poser, nous avons donc pris contact avec l’A.P.D.E.N (Association des professeurs documentalistes de l’Education nationale).
De même que le métier de documentaliste et le centre de documentation ou service d’information ont souffert et souffrent toujours de nombreux préjugés, le CDI de collège et lycée a pour beaucoup l’image d’un lieu de travail plus que d’un véritable lieu dédié à l’enseignement.
Or, on constate que ce métier a considérablement changé au cours du temps et qu’il n’est nullement question de se cantonner uniquement à la politique documentaire d’un établissement. Ces professionnels se définissent avant tout comme des enseignants comme en témoignent leurs nombreux débats et échanges sur les réseaux sociaux et blogs.
L’Association des professeurs documentalistes de l’Education nationale a été créée en 1972 sous le nom de FADBEN, et réunit les associations académiques de la fédération. Les missions de l’association sont essentiellement de proposer une réflexion sur la pratique et l’évolution du métier de professeur documentaliste, en posant pour objectif la formation de tous les élèves du secondaire à la culture de l’information.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
La place des bases de données dans le monde professionnel - Dossier spécial Qui sont les experts des bases de données en entreprise ?
Après avoir abordé la question de la formation, nous avons choisi d’explorer le monde professionnel pour mieux comprendre les évolutions majeures s’étant opérées au cours des dernières années autour de la question des bases de données professionnelles.
Pour cela, nous avons interrogé les éditeurs et producteurs de bases de données, les professionnels de l’information via un sondage en ligne, et enfin recueilli les témoignages de plusieurs managers aux seins de services d’information.
Du côté des éditeurs et producteurs de bases de données
Les éditeurs et producteurs de bases de données sont bien placés pour avoir vu ces évolutions se dérouler sous leurs yeux.
Des interfaces de plus en plus « user friendly »
Avant de nous intéresser à cet aspect, il y a un premier élément majeur à prendre en compte et qui explique en grande partie ces évolutions : l’apparition d’interfaces plus « user friendly » pour interroger les bases de données.
Il y a plusieurs dizaines d’années, l’interrogation de la plupart des serveurs et bases de données professionnelles n’était en rien conçue pour l’utilisateur final. Les professionnels de l’information qui les utilisaient avaient acquis une formation au langage d’interrogation qui était indispensable ainsi qu’à la connaissance des contenus disponibles.
On notera cependant que cet apprentissage se faisait en une ou deux journées. Rien à voir donc avec l’apprentissage d’une langue étrangère. La réticence était plutôt d’ordre psychologique et culturel.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Témoignages et retours d’expérience - Dossier spécial : Qui sont les experts des bases de données en entreprise ?
Nous avons donné la parole à plusieurs professionnels de l’information afin de recueillir leurs témoignages quant à l’évolution de leur métier notamment pour tout ce qui a trait aux bases de données professionnelles.
Ces professionnels sont :
Carole Guelfucci, responsable du service documentation du cabinet d'avocats Darrois Villey Maillot Brochier et auteur du blog Sérendipidoc
Frédéric Riondet, responsable de la documentation centrale, Hospices civils de Lyon ;
Anne-Marie Libmann, directrice des opérations chez FLA Consultants.
Carole Guelfucci, responsable du service documentation chez Darrois Villey Maillot Brochier (cabinet d’avocats) et auteur du blog Sérendipidoc
Des usagers de plus en plus autonomes dans leurs recherches d’informations ?
La seule période de ma carrière où seul le documentaliste était en mesure d’utiliser les bases de données correspond à la période où ces dernières étaient accessibles uniquement sur minitel, puis sur bases de données client-serveur avec un langage d’interrogation spécifique, puis sur CD-ROM avec des postes de consultation uniquement en bibliothèque.
Depuis que les bases de données sont disponibles sur internet, les utilisateurs sont autonomes dans leurs recherches d’information.
D’autre part, dans la mesure où les avocats d’affaires travaillent souvent en dehors des horaires classiques de bureau, ils ont tout intérêt à être autonomes s’ils souhaitent conduire leurs recherches eux-mêmes le soir, le week-end ou les jours fériés.
Quelle formation pour les avocats en matière de bases de données ?
Les futurs avocats se forment à l’utilisation des bases de données pendant leurs stages souvent par eux-mêmes, parfois auprès des documentalistes juridiques.
Malheureusement les facultés de droit ne proposent pas de formation en recherche juridique. J’imagine d’autre part que très peu d’entre eux s’inscrivent volontairement aux sessions de formation organisées par les bibliothèques de droit.
Parallèlement, les éditeurs ont fait des efforts significatifs pour rendre l’interrogation des bases intuitive, parfois au grand désespoir des professionnels de l’information : simplification extrême de la recherche avec une barre à la « Google », suppression de certains opérateurs (comme les opérateurs de proximité par exemple), auto-complétion, thésaurus, tri par facettes, mise en valeur de la recherche simple au détriment parfois de la recherche experte.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Les Tags de Bases
- IA
- brevets
- cartographie
- SEO
- open access
- livrables de veille
- humain
- médias sociaux
- moteurs académiques
- revues académiques
- sourcing veille
- flux RSS
- professionnel de l'information
- dirigeant
- open data
- recherche vocale
- information business
- agrégateurs de presse
- à lire
- conférences salons
- information scientifique et technique
- outils de recherche
- outils de veille
- tendances
- multimédia
- actualités
- méthodologie
- serveur de bases de données
- curation
- due diligence
- recherche visuelle
- outils de traduction
- fake news
- fact checking
- publicité
- géolocalisation
- marques
- appels d'offres
- sommaire
- formation Veille Infodoc
- retour d'expérience
- OSINT
- agenda
- propriété intellectuelle
- presse en ligne
- recherche Web
- évaluation outils
- biomédical
- Questel
- Dialog
- références bibliographiques
- thèses
- résumé automatique
- Bing
- open citation
- Scopus
- veille collaborative
- outsourcing
- veille audiovisuelle
- veille innovation
- infobésité
- études de marché
- données statistiques
- dataviz
- information financière
- Corée du Sud
- Pressedd
- LexisNexis
- Newsdesk
- sourcing pays
- chimie
- e-réputation
- recherche publique
- droit d'auteur
- littérature grise
- archives ouvertes
- veille medias
- dark web
- veille commerciale
- trésor du web
- réseaux sociaux
- veille à l'International
- ist
- ChatGPT
- veille métier
- intelligence économique
- veille concurrentielle
- Bluesky
- podcast
- dark social
- shadow social
- science ouverte
- open source
- veille technologique
- knowledge management
- littérature scientifique
- web of science
- derwent
- abstracts
- protocole
- Intelligence artificielle
- OpenAI
- Commerce conversationnel
- GEO
- veille automatisée
- agents conversationnels
- recherche biomédicale
- veille informationnelle
- Afrique
- copyright